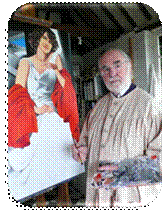 Christian BROUTIN
Christian BROUTIN
Une
œuvre de Broutin est reconnaissable à ce goût fascinant qu’il a pour les
détails, et cette façon de peindre un ensemble avec ses minuscules composantes.
D’autre part, ses représentations du réel sont poussées à un tel degré que nous
acceptons comme normale l’intrusion d’éléments parfois déconcertants pour un
esprit rationnel. Ses compositions, insensiblement, nous amènent à prendre
conscience de mondes invisibles dissimulés derrière d’illusoires apparences.
Cette perception que nous donne parfois sa peinture de mondes autres, à la fois
ressemblants et mystérieux, provient souvent de variations infimes entre espace
et temps. Il refuse la conception d’Aristote d’un univers fini, figé, et la
soumission aux seules apparences qui se manifeste
presque toujours dans la peinture figurative. Il nous donne plutôt à voir une
nature plus ou moins familière dans laquelle se trouve simplement quelque
élément énigmatique. D’où un “écart” qui nous dépayse et qui peut parfois nous
entraîner dans une “sidération” comme, par exemple, celle pouvant survenir dans
la vie par une nuit d’été soudain parcourue d’’étoiles filantes...
Assimiler
Broutin aux Surréalistes, comme pourrait le faire hâtivement un regardeur,
serait simpliste et inexact. “Surréaliste” n’est plus qu’un qualificatif - dont
on abuse souvent à tort et à travers - qui, en fait, concerne très précisément
un mouvement artistique daté et disparu depuis des décennies. Néanmoins,
Broutin pourrait faire sienne cette déclaration d’un grand peintre surréaliste,
historique, lui, René Magritte : “Mes tableaux sont des images. La description
valable d’une image ne peut être faite sans l’orientation de la pensée vers la
liberté.”
Toutefois,
pour en revenir à Christian Broutin, la maîtrise technique et le métier ne
suffisent pas pour faire une œuvre ; il faut aussi ce souffle créateur qui
anime les artistes authentiques, cette “Nécessité Intérieure” pour reprendre
l’expression de Kandinsky. À l’évidence Broutin possède ce don. Son inspiration
aux thèmes souvent oniriques peut parfois sembler insolite ou mystérieuse à un
spectateur pressé ; en fait, elle obéit à une logique invisible qui déroute
seulement les esprits trop cartésiens. Cet imaginaire si personnel, donc
unique, constitué pendant la prime enfance, ne se dévoile qu’à la longue à
l’amateur véritable qui doit dépasser le “maxiréalisme” de certains tableaux,
aller au-delà, pour y découvrir la sensibilité cachée et la naïveté au sens
profond du terme, c’est-à-dire “la simplicité, la grâce naturelle empreinte de
sincérité”. À toutes ces qualités s’ajoute enfin une dimension poétique, et ce
n’est pas un hasard si c’est une femme poète, Andrée Chedid, qui a su le mieux
parler de sa peinture et de ses “images si réelles, si rêvées”.
Georges
Richar-Rivier